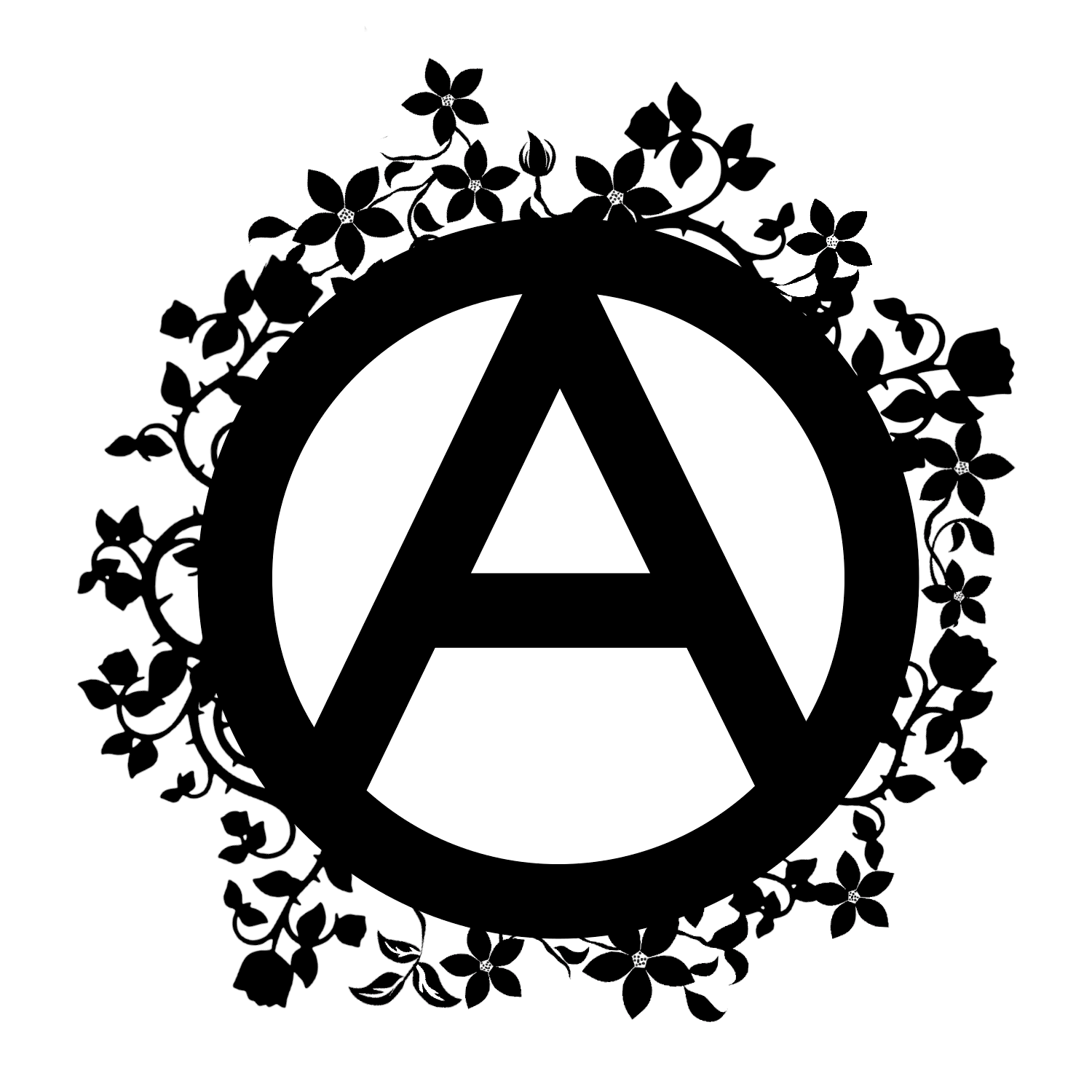Pour un ami qui le trouve chiant à lire
Je sais que tu t’es cassé les dents sur L’Unique et sa propriété et j’avoue que c’est une lecture indigeste. Il paraît que ça coule de source en allemand et que c’est plein d’humour; les traducteurices français·es n’ont visiblement pas eu le mémo. Je vais te faire un court résumé (well, plus ou moins court, tu me connais, han) de ce que moi j’en ai compris. Peut-être que ça te donnera le courage d’y retourner.
Qui est Stirner?
De son vrai nom Johan Caspar Schmidt, il est né à Bayreuh en 1806. Son père, facteur de flûtes – c’était un artisanat de pauvre – est mort alors que le petit Caspar était en bas âge. Sa mère s’est remariée et l’a confié à ses parents. C’est pendant ses études secondaires que ses petits camarades lui donnent le surnom de Stirner, en raison de son front monumental (en allemand, Stirn). Il suit les cours de philo de Hegel à Berlin et ses études ne sont pas brillantes; il ne parvient pas à devenir professeur d’État à l’université et se résigne à donner des leçons dans des établissements privés.
À partir de 1834, Stirner se met à fréquenter la bohème politisée berlinoise, un groupe de jeune gens appelés «les hommes libres» e qu’on connaît de nos jours sous le nom de «jeunes hégéliens» (de gauche). Rassemblés autour de Bruno Bauer (critique radical de la Bible et partisan de l’idée que Jésus n’a jamais existé), des hégéliens s’intéressent à la critique de la religion et à la politique libérale et radicale. En plus de Bauer, les plus connus sont Ludwig Feuerbach, David Strauss… et Friedrich Engels et Karl Marx (que Stirner n’a toutefois jamais rencontré). En 1844, il se marie avec une membre des jeunes hégéliens appelée Marie Daehhardt (leur union fut, je crois, de courte durée).
L’œuvre maîtresse de Stirner est, comme tu le sais déjà, L’Unique et sa propriété (Der Einzige und sein Eigentum, 1844). Il s’agit d’un des textes les plus subversifs de la philosophie moderne. Stirner y démolit non seulement les institutions sociales et politiques de son temps, mais aussi les fondements mêmes de toute morale, de toute religion, et de toute idéologie — y compris celles qui prétendent libérer l’homme. L’ouvrage est à l’origine composé de vingt cahiers de seize pages, pour échapper à la censure. Peut-être que cette stratégie fut heureuse, parce les censeurs ont décidé que L’Unique et sa propriété était trop absurde pour être censuré.
Dans l’immédiat, les censeurs eurent raison. Les idées de Stirner et son audace ont suscité autour de lui un réflexe défensif. Il s’est brouillé avec presque tout le monde autour de lui. Il perd peu de temps après son emploi d’enseignement dans un collège de jeunes filles et mène, durant les dernières années de son existence, une vie extrêmement misérable et va même deux fois en prison pour dettes. Sa mort passe presque inaperçue et son œuvre est presque oubliée lorsqu’elle est redécouverte, une cinquantaine d’années plus tard, par le poète anarchiste John-Henry Mackay.
Longtemps marginalisé, Stirner a exercé une influence souterraine mais considérable. Son individualisme absolu a inspiré des penseurs anarchistes individualistes et plus tard les philosophes existentialistes et post-structuralistes. Pourtant, Stirner demeure inclassable : ni moraliste, ni utopiste, ni humaniste, il est le philosophe de la désacralisation totale et de la liberté sans fondement.
Le rejet des abstractions et des fantômes
Stirner n’avait aucun programme social ou économique. Il n’était pas plus pro-capitaliste que pro-communiste. Ce qu’il revendiquait, de la manière la plus radicale possible, était la primauté de l’individu contre toutes les idéologies et abstractions qui, prétendant le libérer de manière générale et abstraite, le laissaient personnellement et pratiquement aussi subordonné que jamais. Stirner a écrit qu’il avait « basé sa cause sur rien » et il faut le prendre au pied de la lettre : aucun principe général et abstrait ne gouverne et justifie ses idées et ses principes.
Chez Stirner, un « fantôme » n’est pas seulement une idée un peu abstraite. C’est une idée qui a été détachée de son auteur et placée au-dessus de lui, comme si elle avait une dignité, une valeur ou une autorité propres.
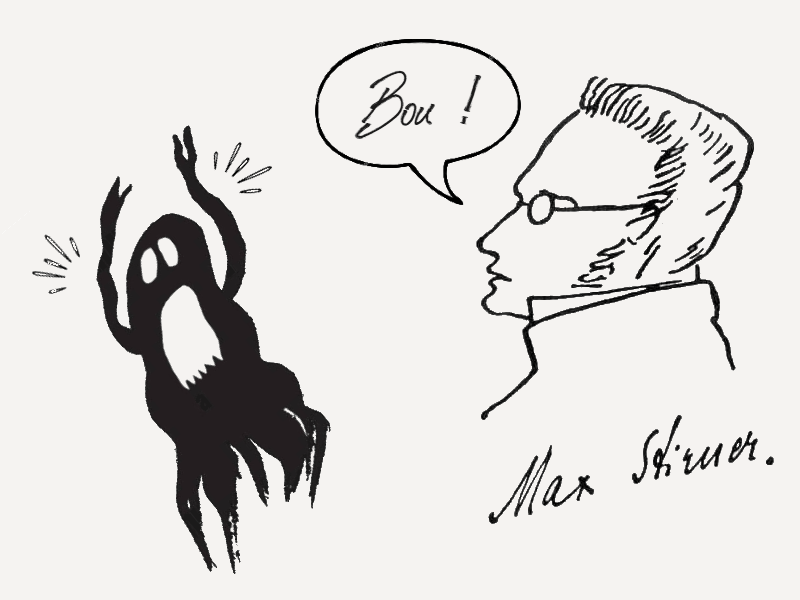
Je te donne un exemple. Si je dis « il faut dire la vérité », ce peut être juste une préférence, un choix, une décision dans une situation donnée. Mais si je commence à parler au nom de « la Vérité » comme d’une chose qui me dépasse, devant laquelle je dois m’incliner même quand cela me nuit, alors la vérité devient un fantôme : une abstraction à laquelle je rends un culte. Je ne dis plus « je veux », je dis « il faut ». Et souvent je ne sais même plus pourquoi.
Un fantôme, c’est donc une idée abstraite érigée en norme supérieure qui réclame obéissance et dont on a oublié qu’elle venait d’un être humain. Stirner utilise très consciemment le vocabulaire de la possession démoniaque. Ce n’est pas seulement une métaphore ; il veut montrer que beaucoup de modernes, qui ne croient plus aux démons, sont pourtant tout aussi « habités » que quelqu’un possédé par Satan. Une idée fixe est une idée qui ne te lâche plus et que tu ne peux plus remettre en question. Ce n’est plus toi qui as l’idée, c’est elle qui t’a. Tu ne dis plus : « J’utilise cette idée parce qu’elle m’est utile », tu dis : « Même si elle me détruit, je dois lui être fidèle. ». C’est pour ça que Stirner parle de possession : tu n’es plus propriétaire de tes pensées, tu deviens le serviteur de tes propres créations.
On peut ranger les fantômes stirnériens en quelques catégories – ça aide beaucoup à le lire. Il y a d’abord les fantômes religieux, ce sont les plus évidents : Dieu, l’âme, le salut. Ils exigent sacrifice, obéissance, abnégation. Il y a ensuite les fantômes moraux, plus insidieux. Ce sont des valeurs présentées comme valables en elles-mêmes : le Devoir, le Bien, la Vérité, la Justice, le Droit. Le problème pour Stirner n’est pas de dire : « aujourd’hui je vais être juste ». Le problème, c’est de croire que la Justice existe comme une chose devant laquelle on doit s’effacer, même si on n’y trouve plus son compte. La morale devient alors une puissance étrangère, un dieu sans visage.
Les fantômes suivants sont politiques et sociaux. On trouve ici l’État, la Nation, le Peuple, la Société, l’Ordre public. Ce sont des abstractions collectives auxquelles on demande à l’individu de se sacrifier : payer de sa liberté, de sa vie, de ses désirs. On nous dit : « c’est pour la Société », « pour la Patrie », « pour la Révolution » — Stirner répond : « montrez-moi cette société, ce peuple ! Je ne vois que des individus ». En disant cela, il ne s’oppose pas par principe à toute forme d’association entre les humains ; il refuse plutôt qu’on sacralise le groupe, qu’on en fasse un fantôme. Le dernier fantôme de Stirner est sa marotte : « L’Homme » avec majuscule, « l’essence humaine », « la dignité humaine ». Tant qu’on nous demande de nous conformer à l’essence de l’Homme, on nous demande de nous soumettre à quelque chose d’abstrait. Mon existence comme la tienne déborde de toutes les définitions de l’Homme. Pourquoi devrions-nous nous y plier ?
Le langage est très important pour Stirner : c’est parce que nous donnons un nom général aux choses que nous finissons par croire qu’il existe réellement « la » chose. On dit « l’État », « l’Homme », « la Justice » — le mot devient une entité. Le langage fige ce qui n’était qu’une relation ou une décision. Stirner nous invite à nous méfier de cette substantification : dès qu’un mot commence à parler à notre place, à être plus fort que nous, c’est que le fantôme se forme.
L’Unique contre l’abstraction
Comment peut-on se délivrer des fantômes ?
Stirner ne dit pas « il faut détruire toutes les idées ». Il n’est pas anti-intellectuel. Il dit : « reprenons les idées comme notre propriété ». Une idée est saine quand nous la manions; elle devient un fantôme quand elle nous manie. Se délivrer des fantômes, c’est donc désacraliser. Ramener les idées du ciel sur la terre. Dire : « l’État, la morale, la vérité, ce sont des moyens, pas des maîtres. Je les garde tant qu’ils me servent, je les quitte quand ils me nuisent. » C’est pour ça que Stirner finit sur la notion de propriété : tout ce que je peux faire mien — pensées, relations, institutions même — est légitime. Ce qui se pose devant moi comme supérieur, intouchable, sacré, est suspect.
Face à ces abstractions, Stirner affirme la primauté de l’Unique (Der Einzige) — c’est-à-dire de l’individu concret, irréductible, insubstituable. L’Unique n’est pas une essence ou une nature humaine, mais une existence vivante, singulière, irréductible à toute définition. Un corps concret qu’on peut voir, écouter et toucher. Le mot allemand der Einzige signifie littéralement « le seul », « celui qui n’a pas d’autre ». Stirner s’en sert pour désigner ce qui reste quand toutes les idées, toutes les appartenances et toutes les définitions ont été rejetées. L’Unique, c’est toi, mais non pas toi en tant qu’homme, toi en tant qu’humain, toi en tant que citoyen, toi en tant qu’esprit rationnel. C’est toi avant tout cela, comme existence singulière, irréductible à un concept.
« Je ne suis pas un rien au sens du vide. Je suis le néant créateur. » Cette formule résume bien la démarche: Stirner ne propose pas une nouvelle essence de l’humain: il nie toute essence. L’Unique n’est pas une substance, ni une âme, ni une nature : c’est une réalité vivante, mouvante, qui ne peut être pensée qu’à la première personne. Hegel et les hégéliens voyaient dans la conscience un moment de l’Esprit universel ; Stirner inverse la perspective : le sujet n’est pas un fragment du Tout, c’est le seul point de réalité. Tout ce que nous appelons « le Monde », « la Société », « l’Histoire » ne sont que des constructions de cet Unique ou de ses semblables.
Ainsi, la pensée de Stirner n’est ni spiritualiste ni matérialiste : elle est égologique au sens fort du terme. L’Unique ne se définit pas, il se vit. Toute tentative de le réduire à un concept est déjà une trahison : « Aussitôt qu’on parle de moi, on parle de moi comme d’un autre », écrit-il en substance.
Parce que l’Unique n’a pas d’essence, il n’a aucune norme extérieure : ni morale, ni religieuse, ni humaine. Il ne cherche pas à « être bon », ni à « être juste », ni à « être homme ». Il veut être soi, dans la plénitude de ses forces, de ses désirs, de sa volonté. Cette position fait de Stirner le penseur d’une singularité absolue, inassimilable à toute philosophie de l’universel. Sa philosophie est un égoïsme radical : non pas l’égoïsme vulgaire du calcul d’intérêt, mais un égoïsme existentiel, qui revendique le droit de chaque être à s’appartenir totalement et à ne rien reconnaître comme supérieur à lui-même. L’Unique n’a pas de devoirs : il agit selon sa volonté, ses désirs, sa puissance.
L’égoïsme comme puissance d’être
Je veux insister là-dessus. Stirner redonne au mot « égoïsme » un sens entièrement nouveau. Dans le langage courant ou moral, l’égoïsme désigne une faute, un repli sur soi, une absence d’altruisme. Pour Stirner, c’est tout le contraire : l’égoïsme est la condition même de la liberté.
Il faut comprendre l’égoïsme de Stirner comme ontologique, non psychologique. Ce n’est pas une attitude morale, mais une structure de l’être : chaque individu existe pour soi. Même celui qui se dit altruiste, charitable, patriote, ne sert en vérité que son propre plaisir ou son besoin de reconnaissance ; mais il se ment à lui-même. Stirner propose de cesser de se mentir : reconnaître que tout acte part de soi, et que c’est bien ainsi.
Cet égoïsme absolu ne signifie pas que tout le monde doive s’affronter. Il implique au contraire que chacun assume sa propre cause : « Je place ma cause en moi-même. » Dès lors, il peut y avoir des alliances, des amours, des échanges — mais sans illusion morale : on se lie parce qu’on y trouve sa satisfaction, non parce qu’une loi morale l’exige.
Stirner distingue souvent deux types d’égoïstes. L’égoïste inconscient, qui prétend servir des causes supérieures : il est encore possédé par des idées. Il est égoïste sans le savoir, car il tire secrètement plaisir et gloire à se sacrifier. L’égoïste conscient, quant à lui, assume que tout ce qu’il fait, il le fait pour lui. C’est celui-là que Stirner appelle « libre ».Le passage d’un égoïsme à l’autre est un processus de désenvoûtement : il faut reconnaître que même le sacrifice ou la charité peuvent être des formes d’affirmation de soi.
L’égoïsme stirnérien conduit naturellement à la notion de propriété (Eigentum). Si je ne reconnais aucun pouvoir au-dessus de moi, tout ce que je peux prendre, créer, penser, aimer, devient ma propriété — non au sens légal, mais au sens existentiel : est à moi ce que je fais mien. La propriété n’est donc pas accumulation matérielle, mais appropriation intérieure. Elle suppose de ne pas laisser les idées, les institutions ou les autres hommes se poser comme des absolus. Le monde redevient un champ d’action et de jouissance, non un ordre sacré.
La critique de la société et de l’État
Tu es encore avec moi? Good ! Je sais que c’est la politique qui t’intéresse, mais il fallait selon moi passer par les fantômes, l’Unique, l’égoïsme et la propriété pour comprendre les positions radicales et surprenantes de Stirner en ce qui concerne la société et ses institutions.
Pour Stirner, la société n’existe pas. Ce n’est qu’une abstraction – un mot vide auquel les hommes donnent une puissance imaginaire. Quand on parle de « la société », on désigne en fait une somme d’individus concrets, mais qu’on oublie aussitôt pour faire place à une entité supérieure qui les domine. Ce processus d’abstraction – exactement comme pour Dieu ou l’Humanité – transforme un simple ensemble de relations en puissance sacrée.
Pour Stirner, ce glissement est dangereux : dès qu’on croit à « la société », on accepte de se soumettre à elle. On commence à parler « au nom » du bien commun, de l’ordre, de la morale publique, etc. On en vient à sacrifier son intérêt, son plaisir, sa vie même à une chose qui n’a d’existence que dans la tête des hommes. Ainsi, la société est pour lui un fantôme politique : une idée abstraite qui a pris le pouvoir sur les individus.
L’État, quant à lui, est la cristallisation de ce fantôme dans le monde matériel. C’est l’instance qui se donne le droit de dire ce qui est bien pour tous, d’imposer des lois, de punir ceux qui s’écartent de la norme. Pour Stirner, l’État repose sur une contradiction : il prétend protéger la liberté des individus, mais il ne peut exister qu’en limitant cette liberté. Il leur dit : « tu es libre, mais seulement dans les bornes que je t’accorde. »
La démocratie elle-même ne résout rien : qu’il y ait un roi, un peuple souverain ou une assemblée, c’est toujours le même principe, celui d’une autorité extérieure à l’individu. Même la République n’est qu’une nouvelle religion : l’État laïc remplace Dieu, le citoyen remplace le fidèle, la loi remplace le commandement divin. Stirner reproche aux révolutionnaires de son temps de n’avoir détruit que la forme du pouvoir, non son principe. Les révolutionnaires de 1789 ont abattu le roi, mais ils ont conservé le trône; ils ont seulement changé le locataire. L’autorité s’est déplacée du monarque au peuple, de la religion à la raison, mais elle reste l’instance devant laquelle l’individu doit s’incliner. « Les libéraux veulent une liberté politique : la liberté de l’homme. Moi, je veux ma liberté », écrit Stirner dans L’Unique et sa propriété. Autrement dit : la liberté politique est encore une liberté donnée, concédée, conditionnelle. La véritable liberté, pour Stirner, est propriété : elle ne dépend d’aucune institution, on se l’approprie.
L’union des égoïstes
Pour bien comprendre Stirner, il faut distinguer trois mots qu’il emploie avec précision. La Société (Gesellschaft) est pour lui un ensemble d’individus unis par des règles, des lois, une morale commune. C’est une structure contraignante, hiérarchique, où l’individu est un rouage. La Communauté (Gemeinschaft), quant à elle est tout lien organique, fusionnel, comme la famille, la nation, l’Église. La Communauté est aussi une structure contraignante, elle exige l’effacement du moi dans le tout.
Ce que propose Stirner, c’est l’union des égoïstes (Verein von Egoisten), une association libre, temporaire, réversible, fondée sur l’intérêt et le plaisir mutuels. C’est selon lui la seule forme de relation compatible avec l’autonomie absolue. Stirner ne veut donc pas abolir tout lien social ; il veut abolir le lien qui exige la soumission. Autrement dit, l’union des égoïstes n’est pas le contraire du lien social: c’est le lien sans esclavage.
L’union des égoïstes n’est pas une utopie ni un projet politique. C’est une figure expérimentale : la forme que peuvent prendre les rapports humains quand on a cessé de croire aux fantômes. C’est un rapport fondé non sur le devoir, mais sur la volonté ; non sur la morale, mais sur la réciprocité. Chacun y participe tant qu’il y trouve du plaisir, de la force ou un intérêt ; il s’en retire librement quand cela cesse.
Stirner illustre souvent son idée par des relations concrètes comme l’amour, l’amitié et le travail. Aimer quelqu’un, c’est s’unir à cette personne parce qu’elle me rend heureux et non parce qu’une loi morale ou divine m’ordonne de l’aimer. De même, on peut travailler avec d’autres parce qu’on y trouve un bénéfice, une joie, une création commune, non parce qu’on a un devoir envers la Société. Cette éthique du plaisir partagé, non du sacrifice, préfigure certains thèmes anarchistes et existentialistes : la valeur d’un lien n’est pas dans sa durée, mais dans sa vitalité.
L’union des égoïstes n’a pas besoin d’une « essence » commune – ni nation, ni humanité, ni destin collectif. Elle n’a pas de structure fixe : elle est événementielle, comme une alliance, un pacte entre pirates, un cercle d’artistes ou d’amants. Ce qui la fonde, c’est la puissance de chacun à se lier sans se perdre. C’est une communauté non totalisante : le contraire du corps social où chacun doit s’ajuster à un rôle.
Il est important de souligner que Stirner précise que toute union doit pouvoir être dissoute à tout moment. C’est une sociabilité sans institution. Il y voit la seule forme de vie collective vraiment libre : parce que personne n’y est indispensable, personne n’y est esclave. C’est le modèle d’une fraternité fluide, mouvante, qui n’a pas besoin d’être garantie par la Loi.
Vers une société post-politique
J’ai dit au début que Stirner ne proposait pas de programme social ou politique. S’il l’avait fait, il aurait créé des abstractions, des fantômes qu’il aurait voulu imposer aux autres. Ce que Stirner propose n’est pas une réforme politique, mais une désacralisation du social lui-même. Il imagine un monde sans institutions qui agissent comme des puissances transcendantes, où les relations humaines seraient sans fondement autre que le consentement individuel.
C’est pourquoi certains anarchistes individualistes (comme E. Armand ou Renzo Novatore, tu devrais les lire !) verront en lui un précurseur, parce qu’il a préconisé un monde de créateurs libres, qui s’unissent par choix et non par devoir. Il serait faux d’y voir un rêve d’anomie : Stirner ne cherche pas le chaos, il cherche la souplesse, la fluidité des rapports. L’union des égoïstes n’est pas absence d’ordre, mais ordre toujours réversible, sans idole et sans maître.
La critique stirnérienne de la société n’est donc pas un rejet du vivre-ensemble, mais un renversement de sa logique. Il ne veut pas détruire les liens, mais les désacraliser ; non pas abolir la solidarité, mais la rendre libre. Là où la société dit : « Tu dois appartenir », l’union des égoïstes dit : « Tu peux t’associer. ». Là où l’État dit : « Servez le bien commun », l’égoïste dit : « Créons ensemble notre bien propre. »
Dans cette vision, la politique s’efface au profit d’une éthique de la souveraineté individuelle et du lien vivant — un monde d’Unique en dialogue, où l’ordre ne vient plus d’en haut, mais de la volonté des êtres libres.
* * *
Voilà mon court (lol) texte d’introduction sur Stirner. Rappelle toi que ce n’est que l’exposition de ce que j’en ai compris. Je ne suis pas une source de Science, d’Autorité et de Vérité, han. Je suis seulement quelqu’un qui a lu Stirner, qui a aimé passionnément son œuvre et qui depuis, a la curieuse manie de mettre des lettres majuscules au début de chaque Fantôme qu’elle croise.